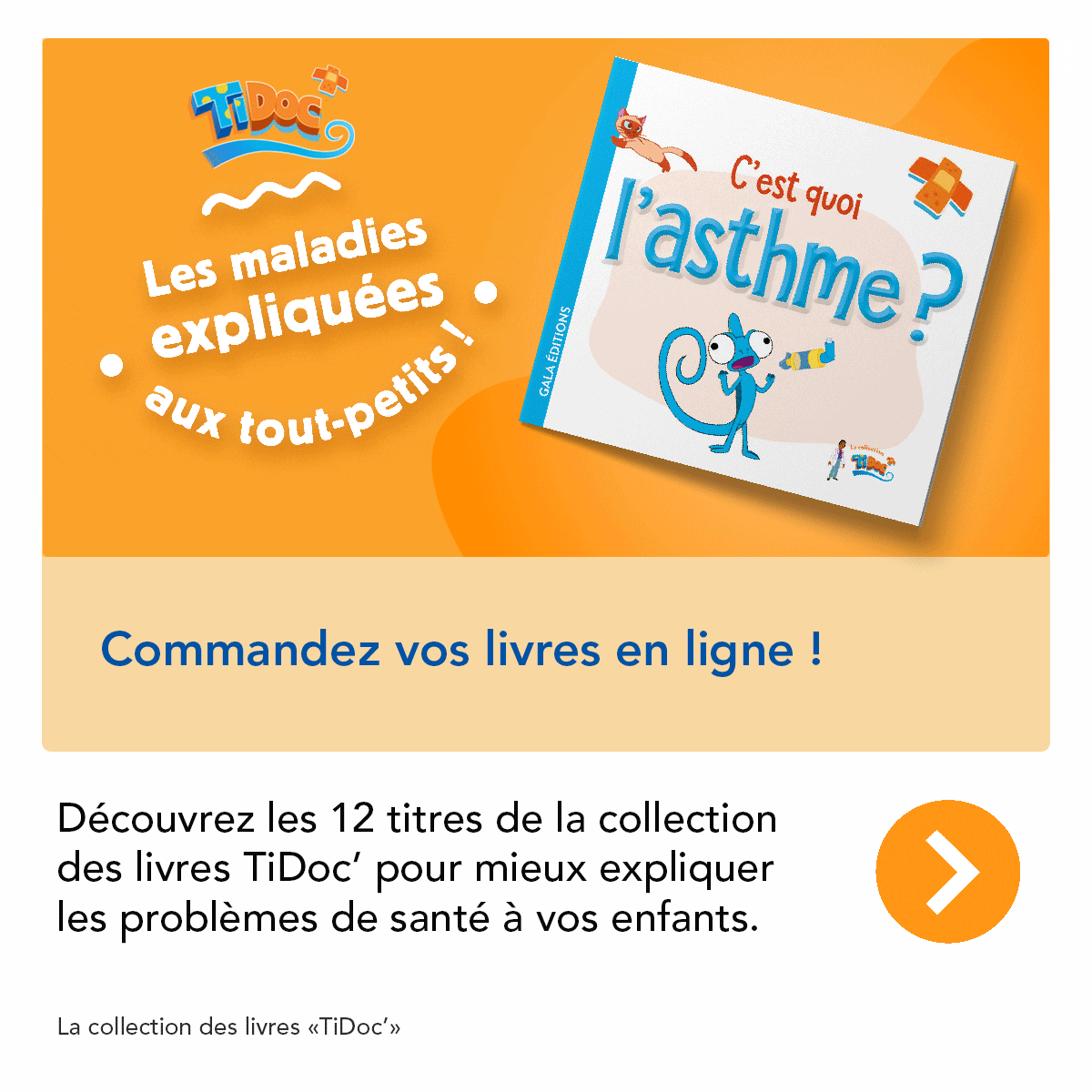La ville intelligente : entre le concept et le « buzzword » règne tout un univers de définitions et de priorités. Montréal a récemment déposé son plan numérique qui viendra mettre la table pour les futurs projets intelligents de la métropole, et ce faisant, elle a pris un parti dans le débat; c’est le citoyen qui devra être au centre de toute initiative. L’administration montréalaise agit-elle comme un modèle à suivre? Un expert nous guide.
« On sent chez l’administration publique de Montréal une volonté de mettre en œuvre une stratégie de ville intelligente. En soi, c’est important, car ce ne sont pas toutes les villes qui ont pris le temps d’y réfléchir », souligne Shin Koseki, professeur adjoint d’urbanisme à l’Université de Montréal et membre de la Chaire UNESCO en paysage urbain de l’Université de Montréal.
Toutefois, selon ce dernier, aucune ville dans le monde ne peut se targuer d’être la ville intelligente idéale.
En effet, le concept est assez récent : la notion de l’intégration des sciences informatiques au développement et fonctionnement des centres urbains a été formulée pour la première fois dans les années 1990 par l’urbaniste français Gabriel Dupuy, et c’est l’ancien président des États-Unis, Bill Clinton qui fut parmi les premiers à évoquer le terme de ville intelligente au début des années 2000.
« Ça ne fait qu’une dizaine d’années que des villes tentent réellement de créer et d’appliquer des politiques en ce sens » -Shin Koseki, professeur adjoint d’urbanisme à l’Université de Montréal et membre de la Chaire UNESCO en paysage urbain de l’Université de Montréal
Ainsi, si des nations comme l’Islande et l’Estonie peuvent être fières de leur forte culture de participation citoyenne et que des villes comme Singapour atteignent des sommets en termes d’innovations techniques, nulle part encore ces deux aspects ont été encore mariés pour créer la ville intelligente idéale.
Et il y a une difficulté supplémentaire apportée par la sémantique dans ce domaine, car si plusieurs décideurs publics s’empressent d’adopter le terme et de le vendre à toutes les sauces, peu s’accordent sur une définition ultime de ce que serait une « vraie » ville intelligente.
Le professeur nous en propose une simplifiée : « Une véritable ville intelligente en est une qui ajuste son fonctionnement en temps réel, qui l’adapte selon les données qu’elle recueille ».
Ainsi, si la manière d’établir des politiques au niveau municipal est traditionnellement uniquement basée sur l’idéologie d’un parti au pouvoir et que l’on mesure l’incidence des décisions prises ultérieurement, dans une ville dite intelligente on définit ces politiques « selon ce qui se passe sur le terrain, en temps réel ».
Les outils du numérique deviennent donc un élément essentiel dans le fonctionnement de la ville intelligente, ces dispositifs étant nécessaires pour recueillir les données qui nourriront les décisions prises par les instances publiques.
PRIVÉ OU PUBLIC?
Si on a beaucoup parlé de la ville intelligente depuis le début des années 2010, c’est parce que le concept entraîne avec lui de gros investissements et offre aux officiels une publicité alléchante.
« Les avantages et les profits de ces projets retombent souvent dans la poche d’acteurs importants, les politiciens, les grandes entreprises du numérique. C’est pour cela que le terme ville intelligente est populaire, parce qu’il vend beaucoup », explique M. Koseki.
Ce fut le cas lors du mandat de l’ex-maire de Montréal, Denis Coderre, qui lors de sa campagne électorale en 2013, promettait de faire de Montréal une « ville intelligente ».
À la suite de sa victoire aux urnes, ce dernier présentait un budget de 400 000 $ pour le fonctionnement du Bureau de la Ville intelligente et numérique et ensuite une autre enveloppe de 100 M$ conjointement financée par 23 firmes de capital de risque pour des entreprises qui s’intéressent au concept de ville intelligente.
Malgré le fait qu’ils soient très ambitieux, de tels projets tombent parfois à plat.
C’est ce qui est arrivé à Sidewalk Labs à Toronto, une idée conjointement élaborée entre l’administration publique de la Ville-Reine et la société mère de Google, Alphabet, qui devait prendre en main la gestion de 12 acres au bord du lac Ontario.
Beaucoup d’encre a coulé à propos de cette aventure qui a fait chou blanc en 2020, entre autres par rapport aux inquiétudes des citoyens concernant l’utilisation de leurs données personnelles par des tiers privés.
Cependant, selon le professeur d’urbanisme, la raison de l’échec de ce projet est ancrée dans des aspects beaucoup plus terre à terre.
« Il y a eu beaucoup d’optimisme à Toronto de la part des instances publiques. On croyait qu’Alphabet pouvait se substituer à la Ville pour offrir les services aux citoyens. Mais une entreprise privée a d’autres priorités aussi, comme la création de marges de profits. Elle ne voudra pas prendre de gros risques en devenant déficitaire. A contrario, une administration publique a le devoir de servir ses citoyens, même si elle est déficitaire », insiste M. Koseki.
Crédit photo: Flickr/Kristina Servant