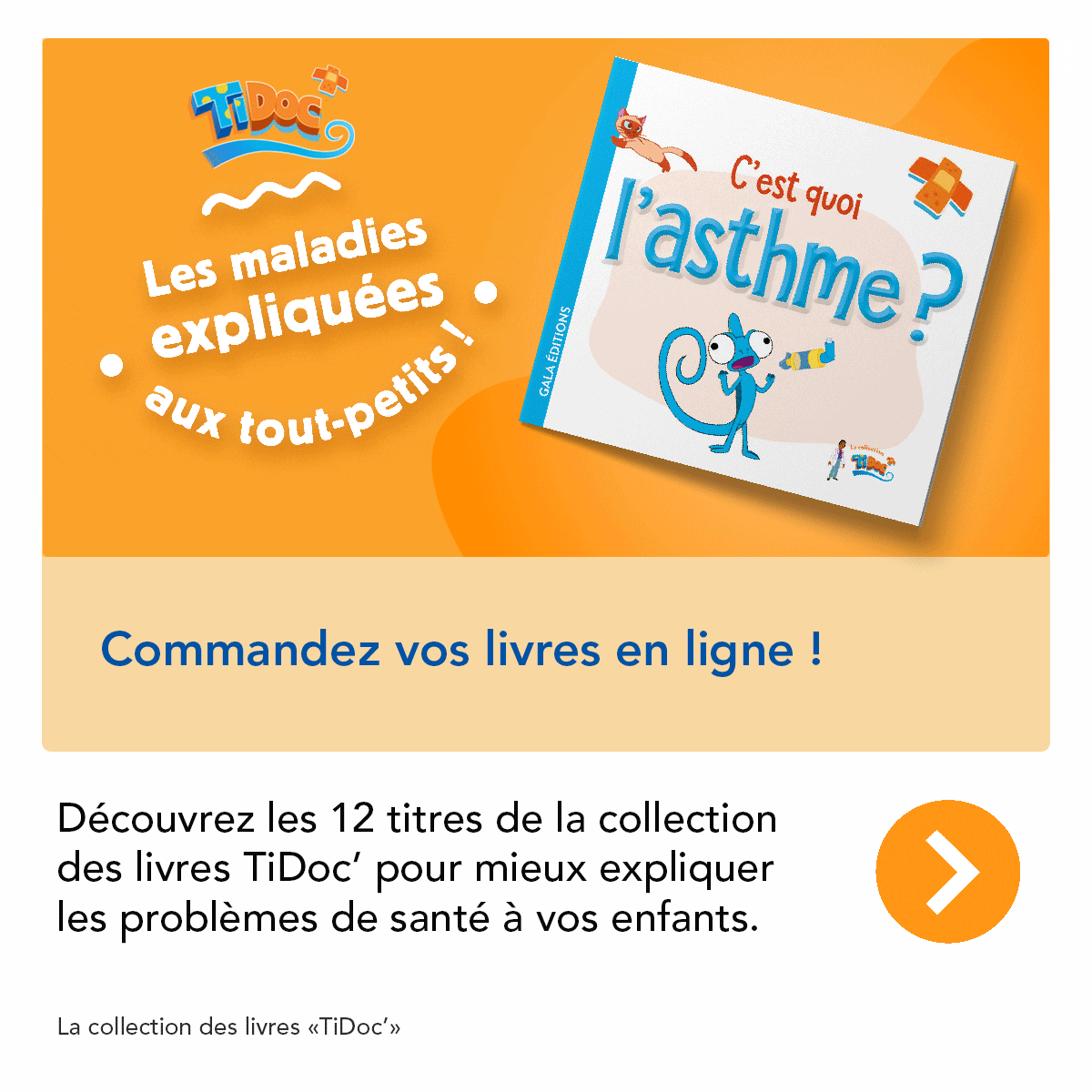Au début du mois, des milliers d’étudiants universitaires, stagiaires postdoctoraux et chercheurs canadiens ont lancé un cri du cœur en manifestant dans les rues d’Ottawa et de Montréal. Parmi eux, des centaines de Québécois, dont plusieurs membres de l’Union étudiante du Québec (UEQ), en ont profité pour réclamer un « salaire décent », alors que certains rapportent n’être payés que 20 000 $ pour leur travail réalisé à l’année.
Des voix qui s’élèvent
Des groupes d’étudiants-chercheurs du Québec se sont joints au mouvement canadien « Soutenez notre science », revendiquant de meilleures conditions, et l’augmentation de la valeur des bourses et subventions fédérales en recherche.
En marge de ces manifestations, il y a quelques jours, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a dévoilé le résultat de son étude sur l’importance de l’Enseignement supérieur dans le développement entrepreneurial du Québec. La même semaine, le 90e Congrès de l’Acfas mobilisait la communauté scientifique francophone, en faisant rayonner les travaux de recherche de dizaines d’étudiants parmi les plus prometteurs.
Mais si tout l’écosystème est d’accord pour reconnaître l’importante contribution des étudiants au monde de la recherche scientifique et de l’innovation entrepreneuriale, les actions pour valoriser concrètement leur apport, elles, tardent à suivre…

Des centaines des Québécois ont pris part ont manifestations. (Photo : Union étudiante du Québec)
« Aucun investissement n’a été fait pour augmenter le montant des bourses depuis 2003. Pourtant, la recherche sans étudiants est tout simplement impossible », a fait valoir, lors de la réunion du 4 mai dernier du Comité permanent de la science et de la recherche, Samy-Jane Tremblay, présidente de l’Union étudiante du Québec (UEQ), qui représente plus de 91 000 étudiants de niveau universitaire, incluant plus de 25 000 étudiants des cycles supérieurs.
« Aucun investissement n’a été fait pour augmenter le montant des bourses depuis 2003. Pourtant, la recherche sans étudiants est tout simplement impossible. »
– Samy-Jane Tremblay, présidente de l’Union étudiante du Québec (UEQ)

Samy-Jane Tremblay, présidente de l’UEQ. (Photo : capture d’écran)
« On se retrouve actuellement dans une situation critique. Le Canada est le seul pays du G7 a avoir réduit ses investissements en recherche et développement depuis 20 ans. Pourtant, d’autres pays ont compris qu’il s’agit d’une priorité, et se fixent des cibles ambitieuses en matière de recherche.
Récemment, le dépôt du rapport du comité consultatif sur le système fédéral de soutien à la recherche de Laurie Bouchard exposait que l’Allemagne prévoit porter ses investissements en recherche à 3,5 % de son PIB d’ici 2025, et à 4,5 % de son PIB d’ici 2030. Le Canada, de son côté, se situe à 1,6 % de son PIB. C’est nettement insuffisant pour être compétitif sur la scène internationale. Le rapport Bouchard l’explique bien : le financement de la recherche n’a pas suivi le rythme des pressions qui s’explique depuis 20 ans », a soutenu Mme Tremblay.
Des chercheurs détournés de leur mission première
La pression serait également très forte pour les chercheurs principaux, qui ont souvent plusieurs chapeaux à porter, en plus de devoir faire des concessions et gérer l’aspect administratif de leur projet.
« Mon directeur de recherche a pris la décision de piger dans ses fonds de recherche pour bonifier les bourses de tous ses étudiants de 3 000$ par an. Il ne veut pas voir le talent quitter son laboratoire pour se ramasser au privé ou sur le marché du travail de manière prématurée », témoigne Alex, un jeune chercheur.
Pour Alicia, qui a baigné dans le milieu de la recherche fondamentale, et dont CScience a fait la rencontre lors du grand rendez-vous EFFERVESCENCE, l’un des problèmes réside dans le fait que passé une certaine étape, « le chercheur principal (souvent appelé PI pour « Principal Investigator ») ne se consacre plus à faire de la recherche, mais bien aux tâches relevant de la promotion de son projet », allant de la demande de subvention à la préparation du protocole, etc.
Le rôle clé de l’enseignement supérieur dans le développement de l’innovation et de l’économie
Un obstacle supplémentaire pour les chercheurs francophones

Samy-Jane Tremblay, Maxime Blanchette-Joncas, et d’autres manifestants à Montréal. (Photo : Union étudiante du Québec)
Certains manifestants prétendent également à l’iniquité des chances pour les Canadiens francophones dans le traitement des demandes de subventions fédérales.
« En parlant avec des gens qui ont déjà siégé aux comités subventionnaires, j’ai appris que certains ne maîtrisaient pas assez la langue française pour bien analyser les demandes de subventions francophones, ce qui génère une forme de discrimination », a affirmé le député de Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques, et vice-président du comité permanent de la science et de la recherche de la Chambre des communes, Maxime Blanchette-Joncas, interviewé par CScience en marge du tournage de l’émission C+Clair sur la science en français, auquel il assistait en tant que spectateur.
Également présente lors du tournage, en tant qu’invitée sur le plateau, la directrice générale de l’Acfas, Sophie Montreuil, faisait valoir que, bien souvent, les chercheurs francophones font le choix de traduire et présenter leur demande en anglais afin d’être certains d’avoir une chance d’obtenir du financement, et qu’il fallait miser « sur des incitatifs qui vont parler à de jeunes chercheurs qui pourraient hésiter à publier en français ».
1/3 chercheurs francophones québécois présente ses travaux de recherche en français dans le cadre d’une demande de subvention fédérale.
– IRSC, CRSNG et CRSH
Rappelons qu’au début des années 2000, la moitié des demandes de financement émises par des Québécois étaient faites en français. Aujourd’hui, les données des IRSC, du CRSNG et du CRSH révèlent que les demandes formulées en français n’en représenteraient que le tiers.
Dans son document de réforme de la Loi sur les langues officielles, paru en février 2021, le gouvernement de Justin Trudeau a reconnu l’importance de la production et de la diffusion des savoirs en français, et l’importance d’établir un continuum d’éducation en français, allant de la petite enfance jusqu’au niveau postsecondaire, attestant d’un point tournant historique pour la communauté scientifique franco-canadienne.
Mais cela reste insuffisant pour M. Blanchette-Joncas : « Actuellement, au fédéral, le constat est assez clair : il n’y a pas de valorisation de la publication scientifique en français. La publication d’un chercheur n’a pas de valeur si elle est en français, parce qu’elle n’a pas de possibilité de rayonnement. Mais si l’on prend l’exemple de la littérature ou du secteur de l’audiovisuel, au Canada, il existe des programmes de subventions destinées au contenu francophone. Ça n’existe pas en science », de remarquer le député bloquiste, qui, lui aussi, était présent lors des manifestations à Montréal.
[Émission C+Clair] Science en français : pourquoi est-ce nécessaire aujourd’hui ?
Les solutions proposées
Soutenir le parcours d’ « étudiants-entrepreneurs »
La DG de l’Acfas n’est pas la seule à entrevoir la mise en place d’incitatifs supplémentaires pour attirer et encourager la relève, non seulement en recherche, mais aussi en innovation entrepreneuriale.
Dans les conclusions de son rapport, par exemple, l’OCDE propose de renforcer l’attrait pour la dimension entrepreneuriale des formations, dans le contexte où les étudiants ayant une idée ou un projet d’affaires à développer auraient du mal à concilier la poursuite de leur rêve entrepreneurial et leurs études : « Les étudiants peuvent avoir de la difficulté à trouver l’équilibre entre leurs engagements entrepreneuriaux et le maintien de leurs performances académiques. Des mesures incitatives pourraient les encourager à s’engager davantage dans des projets d’entrepreneuriat pendant leurs études. »
« Le MES pourrait utiliser les zones d’innovation comme bancs d’essai pour introduire des incitatifs et des opportunités pour les universitaires et les étudiants (par exemple, en faisant la promotion d’un statut d’ ‘étudiant-entrepreneur’). »
– OCDE
L’OCDE recommande notamment d’ « impliquer progressivement le ministère de l’Enseignement Supérieur (MES) dans les politiques publiques en lien avec l’entrepreneuriat et l’innovation, notamment en lui faisant une place dans les zones d’innovation. Le MES pourrait utiliser les zones d’innovation comme bancs d’essai pour introduire des incitatifs et des opportunités pour les universitaires et les étudiants (par exemple, en faisant la promotion d’un statut d’ ‘étudiant-entrepreneur’).
Cela permettrait d’augmenter les retombées des activités collaboratives et participer au mouvement de création d’entreprises dans ces zones. Ces initiatives pourraient éventuellement être étendues dans tous les milieux entrepreneuriaux de la province (et pas uniquement dans les zones d’innovation). »
Tel que l’indiquait d’ailleurs Jacques Robert, professeur titulaire au département d’affaires internationales à HEC Montréal, lors d’une conférence organisée par le Conseil de l’innovation du Québec à laquelle assistait CScience il y a deux semaines, « l’idée des pépites, qui nous vient de nos amis français », est un modèle à prendre en exemple.
« À HEC Montréal, on fait beaucoup pour soutenir l’entrepreneuriat, et en termes de financement provenant du ministère, on a des cours crédités et un département en entrepreneuriat et innovation. On fait beaucoup d’autres choses aussi, comme de lancer des entreprises, etc. Mais le financement provient en grande partie de financement privé philanthropique.
En France, on a développé un modèle que je trouve assez intéressant : le ministère de l’Éducation finance des incubateurs dans différentes universités. Chacune de ces universités dispose de son propre lieu d’accueil de pépites, dont le concept est de créer un statut d’étudiant-entrepreneur, qui ne requiert pas de s’inscrire à un très long programme de cours crédités qui découragerait le lancement d’une entreprise. »
À cela, l’innovateur en chef du Québec, Luc Sirois, a ajouté que le statut étudiant-entrepreneur en France a été inspiré par les étudiants dits « athlètes de performance », pour leur permettre de jouir d’un parcours particulier. Ce concept est également mentionné comme étant une référence dans le rapport de l’OCDE.
Rappelons que c’est dans cet esprit que le tout nouvel Institut multidisciplinaire en cybersécurité et cyberrésilience (IMC2), lancé par Polytechnique Montréal, l’Université de Montréal et HEC Montréal, permettra de soutenir le parcours entrepreneurial d’étudiants au travers du programme Entreprendre en cybersécurité de Propolys.
Cybersécurité : un nouvel Institut multidisciplinaire qui « aura un rôle d’influence »
Des bourses en recherche fondamentale

Rémi Quirion et Frantz Saintellemy. (Photo : Chloé-Anne Touma)
Enfin, la solution la plus évoquée et souhaitable pour remédier aux difficultés des chercheurs sous-payés relève de l’implication et du financement des instances gouvernementales.
« Ça fait longtemps qu’on en discute avec les diverses instances et autorités, que ce soit au gouvernement du Québec, ou au fédéral, en disant qu’il faut commencer par bien investir en recherche fondamentale et non dirigée. Pour moi, c’est la base de tout. Il est certain qu’il faut augmenter nos investissements dans les conseils subventionnaires fédéraux, et offrir des bourses d’excellence avec un grand E pour soutenir les jeunes qui veulent faire carrière en recherche et en science. Au Québec, on a réussi un premier pas avec l’augmentation de la valeur de certaines de nos bourses. Mais il faut que vous (les chercheurs) continuiez et que l’on travaille ensemble pour s’assurer de ne pas sortir de la compétition mondiale, car si l’on se compare à l’international, on voit qu’on prend du retard », a déclaré le Scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, interpellé par CScience lors du dévoilement du rapport de l’OCDE.
« Il y a un maillage à faire entre le milieu privé et la recherche. On y trouverait probablement de l’argent potentiel à redistribuer », a renchéri le Chancelier de l’Université de Montréal, Frantz Saintellemy.
Crédit Image à la Une : L’Union étudiante du Québec était présente lors des manifestations du mouvement « Soutenez notre science », le 1er mai 2023 à Ottawa.